Souverainisme anti-européen et mésusages des références historiques
Le discours des souverainistes est souvent ponctué de références historiques. Ces références ont vocation à légitimer « par l’histoire » des positions anti-européennes pour leur donner un tour moins polémique. Il faut puiser dans l’histoire, ou chez les historiens, des arguments qui tendraient à démontrer que les nations iraient moins bien sans la construction européenne ou que les pionniers de l’Europe unie ont poursuivi d’autres buts que l’idéal européen.
« Le piège européiste » : l’ombre de la défaite de 1940
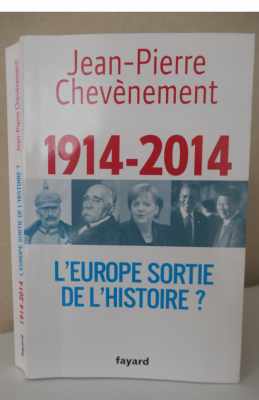
Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014, L’Europe sortie de l’histoire?
Un exemple mérite d’être développé : celui du Français Jean-Pierre Chevènement, plusieurs fois ministre sous François Mitterrand[1], homme très cultivé, qui a écrit de nombreux livres où l’histoire se mêle aux considérations sur le moment présent. D’ailleurs, dans son livre L’Europe sortie de l’Histoire, J.-P. Chevènement regrette que le dialogue entre historiens et politique soit si peu développé en Europe, et en France notamment. Il ne s’agit, dans cet article, d’analyser en quoi la critique que fait J.-P. Chevènement de l’Europe d’aujourd’hui est fondée ou non, en quoi son présupposé de base selon lequel l’Europe serait actuellement en « déclin » et n’aurait guère servi le progrès des citoyens européens mériterait d’être examiné et critiqué. Il s’agit de jeter un regard critique sur l’utilisation que Jean-Pierre Chevènement fait de l’histoire (des événements et des acteurs) pour justifier ses thèses sur ce qu’on a appelé la « construction européenne ».
La grande interrogation de J.-P. Chevènement concerne François Mitterrand, auquel il est relié par une histoire à la fois forte et ancienne. Comment François Mitterrand a-t-il pu convaincre la gauche, une fois au pouvoir en 1981, d’abandonner le cœur de ce qu’on croyait être sa philosophie politique, voire ses valeurs ? Autrement dit, comment la gauche a-t-elle pu s’engager sur la voie de l’acceptation des principes de l’ordre austéro-libéral et de l’idéologie post-nationale ? Et il y a certainement une question intime que JPC a dû se poser à lui-même à maintes fois : comment lui, le défenseur d’une gauche républicaine et nationale, a-t-il accepté de servir un pouvoir qui a conduit à ce qui allait à l’opposé de ses choix profonds ?
Ce reniement a pour cause principale, selon lui, le rapport à l’Europe. François Mitterrand et la gauche auraient été pris dans le « piège européiste ». Ce piège, c’est l’illusion dans laquelle la gauche française s’est enfermée en rêvant d’une Europe qui ne pouvait pas advenir. L’Europe qui s’est faite aurait trompé ceux qui croyaient en elle, ceux qui ont cru en ce qu’elle n’était pas ou ne pouvait pas être. L’Europe, c’est le « marché » qui avance masqué. La gauche aurait cru à ce masque pour ne pas vouloir entendre l’aveu des faits, à savoir le triomphe du libéralisme économique qui allait contre l’idée même d’Europe. Le discours irénique sur les bienfaits de la construction européenne comme stade ultime du progrès politique n’aurait servi qu’à cacher la domination de l’idéologique post-nationale et pro-libérale : on a cru au « marché déguisé au nom de l’Europe ».
Ce piège, François Mitterrand l’a-t-il vu venir ? A-t-il été complice de cette sorte de supercherie historique, voire morale ? J.-P. Chevènement doute. Il connaît l’intelligence de François Mitterrand, et son sens de l’histoire. Il propose une lecture historique de son évolution qui ne manque pas d’intérêt. Deux facteurs d’évolution ont prédominé, selon lui la défaite de 1940 et l’unification de l’Allemagne.
François Mitterrand, le traumatisme de la défaite de 1940 et la réunification de l’Allemagne

François Mitterrand, ministre des Anciens combattants (1947)
J.-P. Chevènement n’oublie pas que François Mitterrand, dans sa jeunesse, a frayé avec l’extrême droite nationaliste, ce qui rend son évolution européiste encore plus étrange. Mais il a vécu un événement historique majeur : le traumatisme de la défaite, le drame de l’Occupation de la France par l’Allemagne nazie. Comme prisonnier de guerre, François Mitterrand a connu dans sa chair la chute de la France. « Je n’ai pas acquis ma propre conviction comme ça, par hasard, dira-t-il, je ne l’ai pas acquise dans les camps allemands où j’étais prisonnier, ou dans un pays qui était lui-même occupé[2]… »
François Mitterrand a cru un moment au maréchal Pétain, pour s’apercevoir vite qu’il s’agissait d’un leurre odieux. François Mitterrand n’a jamais été gaulliste, et encore moins en 1944. Il n’a pas cru au magnifique discours gaulliste énonçant le mythe, du balcon de l’Hôtel de ville de Paris, le 25 août 1944, que la France avait été libérée par elle-même. La France a été libérée aussi et surtout par les armées alliées. Le rôle et le rang de la France en sortent amoindris. Sa substance même est atteinte. C’est de cette conviction intime et durable que J.-P. Chevènement fait partir le processus de repositionnement politique et géopolitique de François Mitterrand. La France n’a plus les moyens d’assumer son destin historique. Elle entre dans la catégorie des « grandes puissances moyennes », comme aurait dit Valéry Giscard d’Estaing. « Au fond de lui, écrit J.-P. Chevènement, François Mitterrand pensait peut-être que la France était morte depuis 1940, et même avant. Cette idée (…) ne m’avait jamais effleuré. » François Mitterrand aurait-il donc été un Européen par dépit ?
Son rapport à l’Allemagne, et donc à l’Europe, serait l’ombre portée de ce traumatisme et de la conviction qu’elle fait naître en lui. Le traité de Maastricht en est la lointaine conséquence.
Le souvenir ce qui est advenu de pire à l’Europe aurait installé en François Mitterrand le désir profond d’une réconciliation avec l’Allemagne, de l’ordre de l’impératif catégorique. L’Europe aurait été victime de l’hyper-nationalisme et du pangermanisme qui avaient trouvé en Allemagne, pour des raisons historiques, son terrain d’élection. Le nationalisme était devenu ce contre quoi l’avenir devait se construire. L’Europe devait donc permettre l’éradication de ce mal et elle devait favoriser la réintégration de l’Allemagne. J.-P. Chevènement raconte combien il a été marqué par la dernière phrase du dernier discours de François Mitterrand au Parlement de Strasbourg, le 17 janvier 1995 : « Mesdames et Messieurs. Le nationalisme c’est la guerre! »
Le poids de l’histoire dans la réaction face à la réunification allemande
C’est ce qui aurait amené le refondateur du parti socialiste au « reniement du projet d’Epinay » et à « la mise en congé de la nation ». Mais c’est aussi la raison pour laquelle il aurait accepté la réunification allemande, en 1989. François Mitterrand aurait été favorable à l’union monétaire pour mettre à bas la puissance du mark allemand et encadrer l’élan vital germanique. Sa stratégie, observe avec pertinence J.-P. Chevènement, était d’accepter la réunification allemande en échange de l’union monétaire, qui devait imposer la normalisation de l’Allemagne et la fin du Sonderweg. Mais il n’aurait pas vu que l’Allemagne (c’est une thèse majeure de la vision géopolitique chevénementienne) ne faisait l’Europe que pour « habiller » sa puissance. J.-P. Chevènement, à tort ou à raison, a peur que l’Allemagne ne puisse pas « maîtriser sa force[3] ». L’Europe d’aujourd’hui, martèle-t-il avec constance, est hégémonisée par l’Allemagne. Sa thèse centrale, contestable, c’est que la réunification de l’Allemagne a engendré « une rétrogradation de la France dans les relations internationales ».
Dans son livre 1919-2014. L’Europe sortie de l’Histoire ?, JPC revient sur la question de la puissance nationaliste allemande par le biais de l’histoire.
Le problème de JPC c’est d’intégrer le fait que l’Allemagne a été prise dans un tropisme nationaliste, ce qui va contre sa thèse de la vertu ontologique de la nation. Que faire de la Ligue pangermaniste qui regardait la guerre dès avant 1914 comme une « solution » ? JPC explique alors, à juste titre, qu’il y a deux conceptions du nationalisme : l’allemande, plutôt ethnique et Völkisch, et la française, plutôt politique et contractualiste. Il sait que « le patriotisme » peut, dans certaines conditions, « sombrer dans le nationalisme » ; « mais le patriotisme républicain ne se confond pas avec le nationalisme ». Cette présomption de confiance dans le nationalisme français explique pourquoi, lorsqu’il explore les origines de la Première Guerre mondiale, JPC n’évoque pour ainsi dire pas les mouvements nationalistes extrémistes qui se développent en France, de la Ligue des Patriotes à l’Action Française.
Une relativisation du rôle du nationalisme dans le déclenchement des deux guerres mondiales
D’où une tendance à exonérer le nationalisme comme cause de la Première Guerre mondiale : « C’est une reconstruction a posteriori et une grossière facilité d’imputer aux nationalismes en général la responsabilité de la Première Guerre mondiale. C’est une manière d’exonérer les élites dirigeantes de leurs responsabilités. » Opposer le peuple, naturellement sage et désintéressé, et les élites, naturellement égocentriques et oublieuses de l’intérêt général, c’est un topic qui revient souvent sous la plume de JPC. Le peuple allemand n’aurait pas été belliciste. La faute incomberait seule à l’aristocratie foncière et militaire, et aussi à l’industrie lourde, dont les intérêts pouvaient justifier la guerre. Et aussi à la social-démocratie allemande qui aurait renoncé à ses valeurs.
J.-P. Chevènement critique la thèse de l’historien Georges Henri Soutou sur les « buts de guerre » de l’Allemagne. Selon l’historien, l’Allemagne n’aurait pas eu le dessein de dominer l’Europe ; elle penchait plutôt en faveur d’une union douanière, pensée dès 1892 par Julius von Eckardt. J.-P. Chevènement tient à la thèse de la « guerre préventive » qui devait permettre à l’Allemagne de conquérir une partie de l’Est Europe. Mais la vraie cause de la guerre, pour lui, c’est la peur qu’a l’Angleterre de la montée en puissance géopolitique de l’Allemagne. La guerre n’aurait peut-être pas eu lieu, croit-il, sans la volonté hégémonique de l’Angleterre et sa peur la nouvelle puissance navale de l’Allemagne (« puissance montante »). Bref, nous serions en présence d’un « conflit d’hégémonie ». C’est pourquoi il plaide pour « disculper » les nations qu’on accuse d’un « crime qu’elles n’ont pas commis : ce ne sont pas elles qui ont voulu la Première Guerre mondiale ; des forces souterraines plus puissantes étaient à l’œuvre, qui les ont jetées les unes contre les autres … » Les pionniers de l’Europe unie auraient-ils donc fait fausse piste en pensant que le nationalisme est à l’origine des deux guerres mondiales ?
Pour ce qui concerne les origines de la Deuxième Guerre mondiale, J.-P. Chevènement formule des hypothèses hétérodoxes, que les nouvelles générations d’historiens ne cautionnent pas. Dans La France est-elle finie, on ne trouvera pas mention de la vague des nationalismes anti-démocratiques et xénophobes qui recouvre l’Europe dans les années 1930. A peine du projet nazi, raciste et hégémonique. Une lecture conspirationniste, largement inspirée des thèses d’Annie Lacroix-Riz, rejetées par l’ensemble de la communauté historienne, prétend que la défaite de la France aurait été voulue par une certaine élite économique. Le mythe de la Synarchie est convoqué. L’élite militaire aurait d’abord été mue par l’anticommunisme, qui l’aurait poussé, par un « calcul inavouable », à « faire se coucher la France devant Hitler pour lui laisser les mains libres à l’Est ». Le patriotisme (forcément naturel) du peuple aurait été victime de cette propagande anti-communiste. Mais rien ne sera dit de l’antisémitisme et du mythe de la « guerre juive » qui gangrènent tant les élites intellectuelles, comme Céline, que le peuple.
Conclusion d’une analyse des deux guerres mondiales : « Les deux conflits mondiaux ont été le prix payé pour l’avènement, au sein du capitalisme avancé, d’un nouvel hegemon : les Etats-Unis d’Amérique. »
J.-P. Chevènement estime que le rejet du nationalisme par François Mitterrand l’a conduit à oublier la nation. L’horizon de son projet européen portait donc en germe la fin de la nation. L’ancien ministre reproche donc à François Mitterrand (et aux européistes en général) de considérer la nation comme une catégorie politique dépassée et dangereuse, oubliant que c’est par la nation que la culture démocratique et les valeurs républicaines ont pu se développer. Le projet européen serait donc ontologiquement anti-démocratique et anti-national.
J.-P. Chevènement croit avoir identifié l’homme par qui cette contagion idéologique est arrivée. C’est Jean Monnet. Il est celui qui aurait « piégé » Mitterrand. C’est l’inspirateur, voire le comploteur. D’ailleurs, note-t-il, c’est François Mitterrand qui transfère ses cendres au Panthéon, le 9 novembre 1988, un an avant la chute du mur de Berlin.
L’Europe soumise dès l’origine au nouvel hegemon américain ?
Pour J.-P. Chevènement, qui lui accorde un pouvoir immense, Jean Monnet est l’homme qui a voulu briser le fait national et désintégrer la France dans une Europe fédérale. Il aurait été le continuateur des projets d’union douanière de Julius von Eckardt et de Stresemann à travers l’idée d’ « un marché commun paneuropéen ». Il le présente aussi et surtout comme « l’homme des Américains », celui qui aurait voulu contribuer à installer durablement l’influence américaine en Europe. Monnet n’aurait pas voulu les Etats-Unis d’Europe, comme Victor Hugo, mais l’Europe des Etats-Unis. Jean Monnet apparaît donc comme l’homme qui a parachevé la dégradation géopolitique de la France. JPC le classe dans la catégorie des « vichysto-résistants » et des « giraudistes », c’est-à-dire des anti-gaullistes. Jean Monnet s’est retrouvé à Alger, en 1943, appuyant le général Giraud avant que De Gaulle ne s’y installe et prenne le pouvoir. Giraud était en effet l’homme de confiance des Américains (lesquels ne supportaient pas de Gaulle, car celui-ci était perçu comme un dictateur). Grâce à cette confiance, l’armée d’Afrique a pu reconstituer. Comprenant que Giraud n’avait aucune envergure politique, Jean Monnet s’engagea aux côtés de De Gaulle et entra au Comité français de la Libération nationale. Il n’en demeure pas moins que son patriotisme est présenté comme suspect. En fait, la réalité est beaucoup complexe.
Un de ses biographes résume assez bien la situation : « Jean Monnet pour sa part se veut libre. Depuis le début, on commence à le savoir, il n’est pas venu pour soutenir le général Giraud, et s’il a les solides préventions que l’on connaît à l’encontre de De Gaulle, il n’entend pas aliéner sa liberté par des considérations hors de saison. »
Monnet était-il l’homme des Américains ? Quand Giraud remet ses pouvoirs au général de Gaulle, Robert Murphy, le représentant du gouvernement américain en Afrique du Nord, est « furieux », convaincu que Monnet a trahi. Murphy lui demande des explications. Voici un compte rendu de cette réunion :
« Il (Monnet) nous écouta assez froidement et nous répondit qu’i n’avait pas à nous renseigner sur des questions de politique intérieure française. (…) C’est grâce à ces documents (des lettres de créance données à Jean Monnet par le président Roosevelt) que Monnet a élevé de Gaulle au pouvoir en complète contradiction avec les desseins de Roosevelt au sujet de l’Empire français. (…). Son habileté diplomatique a bien servi sa patrie durant un demi-siècle mais jamais de manière aussi efficace qu’à Alger. »
Lorsque Monnet se rend à Washington, c’est pour obtenir la reconnaissance américaine du CFLN dirigé par le fondateur de la France Libre. Il négocie l’accord créant l’administration du secours et de la Reconstruction. Il veut le rétablissement des principes républicains : Monnet lutte à Alger, à l’automne 1943, pour remettre en vigueur le décret Crémieux (1872) qui avait donné la nationalité aux juifs mais que Vichy avait supprimé. Giraud y était hostile.
Venons-en à sa conception de l’Europe. Sa longue note du 5 août 1943 est assez explicite sur sa stratégie : « En outre, dans une Europe libérée, mais où l’Allemagne et l’Italie seront écroulées, la France redevient la première puissance continentale. » Monnet, comme d’autres, est convaincu que la France peut recouvrer de l’influence à travers une Europe ravagée par la guerre, l’Allemagne et l’Italie étant des pays privés de toute capacité de puissance et d’autonomie stratégique. Mais ce n’est pas qu’une question de rapport de force. Jean Monnet explique : « Les buts à atteindre sont : le rétablissement ou l’établissement en Europe du régime démocratique et l’organisation économique et politique d’une entité européenne. » Il faut tout faire pour éviter les traités de 1919 qui ont humilié l’Allemagne et qui n’ont pas pu rendre la paix durable. Enfin, il y a chez Jean Monnet la prise de conscience que la mondialisation qui se dessine exige de penser à une autre échelle qu’à l’aune de la nation : « Les pays d’Europe sont trop étroits pour assurer à leurs peuples la prospérité que les conditions modernes rendent possible et par conséquent nécessaire. Il leur faut des marchés plus larges. »
Son désir de paix est sincère. Il pense que c’est par l’économie que la redynamisation politique de l’Europe peut se faire. D’où son idée de constituer un « Etat européen de la grosse métallurgie » autour du charbon et acier : « Il faut soustraire ces territoires aux Etats qui les possèdent et rendre la guerre impossible[4]. »
Jean Monnet, Henri Frenay et François Mitterrand

Henri Frenay au début des années 1940
Un homme qui a une influence capitale à la fois sur Jean Monnet et François Mitterrand n’apparaît pas dans les livres de JPC. C’est Henri Frenay.
L’homme qui a « inventé » la Résistance intérieure, pour reprendre l’expression de Jacques Baumel. Il a créé le plus grand mouvement de Résistance, Combat, il a été l’instigateur de l’unification des mouvements de Résistance. De Gaulle en fit un ministre à la Libération et un Compagnon de la Libération. Voici ce que dit de lui Jean Monnet :
« Mais j’avais encore à découvrir la Résistance dans les individualités dont le tempérament sortait du commun, tel Henri Frenay qui était devenu notre collègue. Ce qu’il a fait, avec d’autres, plus que d’autres, me remplit d’admiration. Sa force inébranlable et sa générosité survécurent aux drames qui les avaient révélées et ne trouvèrent pus leur mesure entière dans le milieu politique de l’après-guerre. »
Or, quand il se rend à Londres pour entrer en contact avec de Gaulle, en novembre 1942, alors qu’il est pourchassé par la police de Vichy et les forces de répression de l’occupant, Frenay plaide en faveur d’une manière de faire de la politique quand la guerre sera finie. Dans une lettre datée du 8 novembre 1942, c’est-à-dire le jour même où les Américains débarquent au Maroc et en Algérie, le fondateur de Combat explique au général de Gaulle que le nationalisme n’a plus sa place dans la vie politique française et que les Français aspirent à un patriotisme « purifié par l’épreuve », généreux, ouvert, soucieux « d’un universalisme plus grand qu’on avait coutume de le rencontrer avant la guerre ». Frenay développe les thèses qu’il a déjà eu l’occasion d’exprimer. Et ce dès septembre 1942, dans le « Manifeste » de Combat qui condamne l’Europe présente « asservie par la schlague d’une Allemagne ivre de sa force » et en appelle à une nouvelle Europe post-nationale :
« La révolution que nous portons en nous est l’aube d’une civilisation nouvelle. C’est là qu’est le sens de la guerre civile mondiale. L’histoire nous enseigne l’élargissement constant des frontières. Les États-Unis d’Europe, étape vers l’unité mondiale, seront bientôt une réalité vivante pour laquelle nous combattons. »
On voit que la volonté de « faire l’Europe » n’est pas un complot servant les intérêts de Jean Monnet et des Américains. C’est un mouvement de fond.
Mitterrand lui-même sera en lien dès l’Occupation avec Henri Frenay, future figure emblématique du fédéralisme européen. En effet, il a été protégé pendant une partie de la guerre par la famille Gouze, future belle famille de François Mitterrand. Entre eux, des liens très forts se sont noués. Ils habitaient sur le même palier après-guerre, rue Guynemer. Frenay a fondé l’UDSR (union démocratique et socialiste de la Résistance) à laquelle François Mitterrand a adhérée et qui a été son marchepied politique. Le programme de l’UDSR était résolument européiste. C’est dire que la conviction européenne de François Mitterrand était ancienne. Il la partageait avec Jean Monnet depuis longtemps.
L’européisme ne saurait donc être ramené à une volonté de destruction des nations pour faire le jeu de l’hegemon américain et conduire la France sur les chemins du libéralisme. Le sentiment européen a été renforcé par la Résistance, qui a été un combat mais aussi un projet politique. Ceux qui ont prôné l’unification de l’Europe à la Libération ont aussi été ceux qui ont risqué leur vie pour la patrie. Monnet, Frenay et Mitterrand rêvaient d’une Europe européenne qui serait l’arme absolue contre la guerre.
Robert Belot
Bibliographie
Belot, Robert, Henri Frenay, de la Résistance à l’Europe, Paris, Seuil, 2004
Chevènement, Jean-Pierre, 1914-2014. L’Europe sortie de l’Histoire ?, 2014
Chevènement, Jean-Pierre, La France est-elle finie ?, Pars, Fayard, 2011
Monnet, Jean, Mémoires, Paris, Fayard, 1976
Murphy, Robert, Un diplomate parmi les guerriers, Paris, Robert Laffont, 1965
Roussel, Eric, Jean Monnet, Paris, Fayard, 1996
Soutou, Georges-Henri, L’Or et le Sang. Les buts économiques de la Première Guerre mondiale, Pars, Fayard, 1989
https://www.fondation-res-publica.org
[1] François Mitterrand a été président de la République du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. C’est lui qui a permis à l’Europe d’entrer dans sa deuxième phase, la plus intégrative, avec le traité de Maastricht (1992), qui a donné naissance à l’Union Européenne.
[2] Discours de François Mitterrand au parlement européen, 17 janvier 1995.
[3] Jean-Pierre Chevènement, La France est-elle finie ?, Fayard, 2011, p. 128.
[4] Témoignage d’Etienne Hirsch à Eric Roussel, cité par Eric Roussel, Jean Monnet, Fayard, 1996, p. 392.

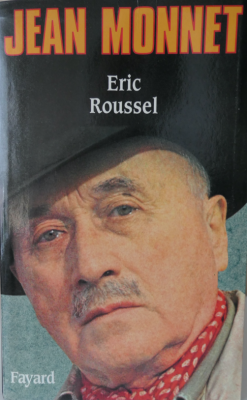
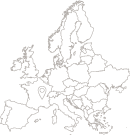 Université Jean Monnet
Université Jean Monnet