De Gaulle et la future « union européenne » en 1942
 Certains Français engagés dans la résistance à Vichy et au nazisme vont très tôt penser à l’Europe d’après-guerre et à la réintégration-normalisation de l’Allemagne, alors même qu’ils se trouvent engagés dans une lutte frontale avec « l’ennemie éternelle ». Parmi ces Résistants, un homme d’exception, Henri Frenay, fondateur du plus grand mouvement de Résistance : Combat. Il se rend clandestinement à Londres, à l’automne 1942, pour convaincre le général de Gaulle, l’inventeur de la France Libre, d’européaniser son discours. Une lettre-programme, restée inédite, écrite le 8 novembre 1942, révèle à la fois la préscience du futur combattant fédéraliste et la difficulté de De Gaulle à sortir d’une géopolitique dépassée.
Certains Français engagés dans la résistance à Vichy et au nazisme vont très tôt penser à l’Europe d’après-guerre et à la réintégration-normalisation de l’Allemagne, alors même qu’ils se trouvent engagés dans une lutte frontale avec « l’ennemie éternelle ». Parmi ces Résistants, un homme d’exception, Henri Frenay, fondateur du plus grand mouvement de Résistance : Combat. Il se rend clandestinement à Londres, à l’automne 1942, pour convaincre le général de Gaulle, l’inventeur de la France Libre, d’européaniser son discours. Une lettre-programme, restée inédite, écrite le 8 novembre 1942, révèle à la fois la préscience du futur combattant fédéraliste et la difficulté de De Gaulle à sortir d’une géopolitique dépassée.
La lettre est datée du 8 novembre 1942, c’est-à-dire le jour même où les Américains débarquent au Maroc et en Algérie. Evénement majeur qui marque le tournant de la guerre et offre de nouvelles perspectives. A midi, Frenay déjeune avec Sir Charles Hambro, chef des services spéciaux de Sa Majesté. Il lui parle du général Giraud, avec qui Frenay a été en contact. Quel rôle pourrait-il jouer en Afrique du Nord ? Peut-il s’entendre avec de Gaulle ? Le Comité national français se réunit à 17heures. Puis, le Général le reçoit dans son bureau et le dissuade de rencontrer Giraud que les Américains s’apprêtent à adouber. Le soir de cette journée historique, Frenay invite le Général à « penser le monde de demain ». Une lettre-fleuve de 16 pages qui ressemble à une profession de foi et à un programme politique pour l’avenir.
Construire la paix européenne par l’équilibre géopolitique

Malgré leur opposition sur l’Europe, De Gaulle nommera Henri Frenay comme Commissaire dans le Comité français de la Libération nationale qui naît à Alger en 1943. Frenay se situe près de l’épaule gauche de De Gaulle.Le patron de Combat explique au général de Gaulle que le nationalisme n’a plus sa place dans la vie politique française et que les Français aspirent à un patriotisme « purifié par l’épreuve », généreux, ouvert, soucieux « d’un universalisme plus grand qu’on avait coutume de le rencontrer avant la guerre ». D’abord, il y a le fait que la Résistance française est « en général orientée à gauche » ; la droite (nationaliste ou pas) « s’est abstenue ou a trahi », sa conception du patriotisme « ne peut plus être prise en considération ». Ensuite, « le pays », « dans son ensemble » assure Frenay, ne considère pas que « la paix future puisse être garantie par un retour intégral aux formules du passé ». Il faut à tout prix éviter de rééditer ce qui a été fait après la Grande Guerre, en proscrivant une paix de « vainqueurs » qui divise et ampute les territoires et qui crée des zones désarmées. Il faut de même tourner le dos à une politique européenne basée sur un système d’alliances et sur une conception des rapports entre les nations reposant sur des logiques de puissance.
C’est la philosophie même des relations internationales que Frenay se propose de faire évoluer pour que l’Europe rompe avec deux siècles de guerres. L’ordre international nouveau ne saurait être stable s’il repose sur une conception « archaïque » qui provoque et entretient les inégalités économiques et territoriales, entretenues par l’émiettement des unités politiques qui sert des stratégies occultes d’hégémonie ou d’intérêts au nom des grands principes. Il est convaincu que « les traditions de la diplomatie française » ne pourront aboutir qu’à une « solution archaïque et précaire » qui serait une sorte de « trahison de la volonté populaire » :
« Nous, à Combat, sommes convaincus que les crises politiques, économiques, militaires qui ont secoué le monde dans les dernières décades sont des preuves multiples et éclatantes d’une même nécessité : refaire les fondations morales, économiques et politiques sur lesquelles la vie internationale a été édifiée. Nous pensons que la vérité n’est pas aux entrepreneurs à courte vue mais aux architectes audacieux. »
Frenay met alors en garde de Gaulle contre une « grossière erreur lourde de conséquences » qu’il a entendu professer par certains Français de Londres et qui va contre la thèse de Combat. Cette erreur, c’est de croire que la stratégie de sortie de guerre doive s’effectuer en deux temps : règlement du problème allemand, puis résolution de la question économique. Pour Frenay, qui montre ainsi qu’il a réussi à dominer un inconscient collectif hanté par la névrose germanophobe, le problème allemand n’est que la résultante d’un déséquilibre économique et géopolitique qui doit être pensé à l’échelle de l’Europe.
Henri Frenay n’hésite pas à attaquer la pierre d’angle de la vision géopolitique du général de Gaulle en expliquant que les totalitarismes sont nés de la « détresse » économique des peuples à laquelle les démocraties les ont contraints par la mauvaise paix de 1919 : « Si les pays totalitaires portent la responsabilité rapprochée de la guerre, ce sont les pays démocratiques qui en portent la responsabilité lointaine. Hitler et Mussolini sont leur création. » Ce n’est pas un hasard si « l’esprit » prussien « plonge ses racines dans les terres les plus déshéritées du Reich ». Trouvons les moyens de créer les conditions favorables à un équilibre géopolitique en Europe générateur de développement économique et social, et les causes des conflits seront supprimées : « Vienne l’existence devenir douce en Allemagne et je suis convaincu que le prussianisme prétendu éternel amorcera son déclin ». Le problème capital à résoudre, soutient Frenay, c’est « le fait économique ». Pour cela, il faut changer de paradigme de lecture des relations franco-allemandes et abandonner les mythes politiques. Il faut oublier le mythe belligène de « l’Allemagne éternelle », recommande Frenay à un homme qui, à la radio de Londres le 17 septembre 1941, déclarait : « La guerre contre l’Allemagne a commencé́ en 1914. […] Le monde fait la guerre de trente ans, pour ou contre la domination universelle du germanisme ». Deux analyses diamétralement opposées. C’est par le haut et vers l’avant, rêve Frenay, qu’il est peut-être enfin possible de mettre fin à la fracture historique franco-allemande, source du mal européen.
Le souverainisme dépassé par « l’évolution historique »
La question se pose dès lors d’une responsabilité collective des démocraties qui auraient « trahi les principes de générosité, de justice, d’égalité qu’elles affirment défendre aujourd’hui ». Cela suppose de repenser à la fois la géopolitique de l’Europe, la question de la souveraineté nationale et la notion de libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout ce qui peut entraîner un « morcellement de l’Europe » et la domination d’une nation sur une autre.
« L’erreur capitale, le péché mortel devant l’histoire serait de vouloir restaurer ces États dans la plénitude d’une illusoire souveraineté. Le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, étant donné la mosaïque de peuples qui constitue le continent européen, doit être considéré comme l’une des causes principales de la guerre actuelle. La souveraineté des États nés des traités de Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon était un mythe qui pouvait donner satisfaction à des nationalistes bornés mais ne pouvait faire illusion à des hommes d’État clairvoyants. La souveraineté n’est d’ailleurs pas une fin mais un moyen. Elle est le moyen de protéger les valeurs morales éternelles auxquelles un pays est attaché. Or à l’époque actuelle, la souveraineté se définit non seulement par une indépendance politique et militaire, mais encore et surtout par l’indépendance économique sans laquelle les autres formes d’indépendance ne sont qu’un leurre dangereux. En fait, les États nés de la dernière guerre ne furent jamais souverains. Les nécessités économiques les ont tous plus ou moins contraints d’aliéner une part importante de leur souveraineté au profit d’États plus favorisés. »
La souveraineté, affirme Frenay est un « leurre » ou un « mythe » dangereux en situation de dépendance économique. Plus encore, la souveraineté, dans le « siècle où nous vivons », est une illusion dans un monde que la guerre a transformé et a réuni par la force. Les négociateurs de la paix, qui ne doivent avoir qu’une préoccupation : « éviter le retour de la guerre en Europe », doivent comprendre cet enjeu. Cela veut dire pour lui : éviter le « morcellement de l’Europe ».
C’est alors que Frenay expose la théorie qui l’a conduit au fédéralisme européen. La loi de l’histoire du monde contemporain, selon lui, et la guerre « mondiale » lui donne raison, c’est l’interdépendance généralisée à laquelle les Etats doivent s’adapter ou mourir : « L’évolution historique du monde met en évidence une loi fondamentale plus forte que les hommes : les frontières vont en s’élargissant et non en se rétrécissant. Le monde s’achemine, parfois dans la douleur, vers une unité toujours plus large et plus profonde. » La révolution, c’est la nécessité de dépassement de culture stato-nationale pour accéder à des entités géopolitiques plus transnationales qui organiseront la solidarité à une échelle nouvelle.
Le Résistant Frenay ne nie pas l’existence du fait national et du patrimoine qu’il représente. « Il est cependant naturel que chaque nation veuille conserver et protéger ce qui fait son originalité : sa langue, ses coutumes, ses mœurs, sa religion, ses traditions, sa conception de la vie, tout ce pour quoi actuellement les hommes combattent et meurent. » Le patrimoine national est pour lui une « donnée spirituelle permanente ». Pour autant, il n’y a pas forcément congruence entre la nation et l’Etat. Il faut même « admettre le divorce nécessaire entre les deux notions ». L’Etat peut être une « somme de nations conférant à chacune d’elle la sécurité intérieure et extérieure qu’elle revendique légitimement et possédant la souveraineté totale ». Il n’est donc pas question d’envisager « de morceler une Nation par le trait de plume rageur d’un diplomate rancunier », mais « d’élargir les unions politiques ».
Pour Frenay, il faut éviter de créer des « blocs » économiques en Europe, car les richesses sont inégalement réparties, ne serait-ce que parce que les pays de l’Ouest européen ont des colonies, contrairement à l’Est européen, dont les pays ont pourtant les mêmes besoins. Un principe de solidarité (même s’il n’écrit pas le mot) doit régir cette nouvelle union politique. Seul l’État multinational a vocation à abriter plusieurs nations pour leur permettre d’accéder à une masse critique économique et à inventer une souveraineté « totale » mais évolutive susceptible de s’élargir en fonction du développement technique et économique mondial. A la démocratie dans un seul pays doit succéder la démocratie internationale. L’ultime étape de ce processus est naturellement la constitution d’une « fédération européenne disposant d’un fonds colonial commun ». Il sait que cette proposition suscitera des « clameurs » hostiles ! La paix à venir doit être « révolutionnaire » si l’on veut détruire les risques de guerre. On voit clairement dans cette intuition les linéaments de ce à quoi ressemblera la construction européenne. Que l’Europe prenne exemple sur l’URSS, les Etats-Unis ou la Suisse.
Un autre regard sur l’Allemagne
Unir l’Europe, ça veut dire intégrer l’Allemagne. Là est la pierre d’achoppement. Il faut imaginer l’inimaginable et se mettre à hauteur d’avenir. « Mais alors, dira-t-on, vous laissez subsister en plein cœur de l’Europe un bloc allemand de 80 millions d’hommes, plus nombreux que ses deux plus grands voisins ? » De manière iconoclaste, Frenay se réjouit de l’unité allemande, un « fait historiquement acquis ». Et il pourfend les historiens nationalistes, atteints de « conservatisme historique », qui rêvent de replacer l’Allemagne dans un état voisin de celui de 1803, incapables de comprendre que l’unité allemande est « une expression capitale de cet effort permanent et douloureux des peuples vers une unité toujours plus grande et plus profonde [qu’il] considère à la fois comme une nécessité et un bien ». Pour Frenay, l’historien Jacques Bainville, dont la jeunesse s’est déroulée après la défaite de 1870, n’a pas pu « élever son esprit à juger bon pour autrui ce qui l’avait été pour la France », et il a jugé l’Allemagne « à travers le prisme des intérêts français et non à travers celui des intérêts de l’humanité ».
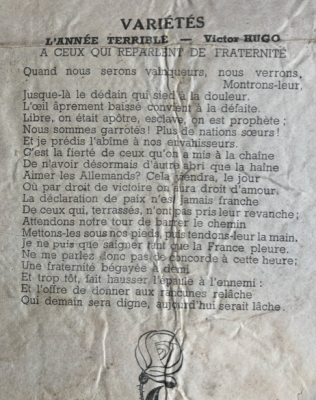
Le journal clandestin Vérités, dirigé par H. Frenay, cite un poème de Victor Hugo qui parle de la future « fraternité » dans la dignité à organiser avec celui qui sera vaincu. @coll. R. Belot
Il sait qu’en disant cela, il franchit une limite que le général de Gaulle pourrait ne pas accepter. Concernant l’unité allemande présentée comme un phénomène irrévocable, il précise :
« J’ajoute même, au risque de paraître sacrilège, que je m’en réjouis car elle est une expression capitale de cet effort permanent et douloureux des peuples vers une unité toujours grande et plus profonde que je considère comme une nécessité et un bien. »
Ce postulat de l’irréversibilité de l’unité allemande entraîne des conséquences géopolitiques très concrètes pour l’avenir. A Londres, au cœur de la France Libre, Frenay a entendu parler de la thèse de la fragmentation de l’Allemagne. Il le dit franchement au général de Gaulle : « Je suis attristé lorsqu’on fait état devant moi des différences qui existent entre les régions allemandes du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, et qu’on conclue à la possibilité d’une mutilation du territoire allemand. » Selon lui, on ne peut tenir pour rien le fait que l’unité allemande a été « forgée dans quatre guerres » ; il serait dangereux de négliger que « le lien du sang versé en commun joint au lien linguistique est le meilleur et le plus prompt des ciments ».
Frenay prévient qu’il convient de renoncer à la tendance de la diplomatie française à vouloir opérer une mutilation du territoire allemand qui ne fera que ranimer l’irrédentisme et former « délibérément les bataillons de la revanche ». Un homme comme Jacques Maritain est sur la même ligne. Chef de la délégation française à la première réunion de l’UNESCO, il plaide pour une politique de la main tendue à l’égard de l’Allemagne « afin de l’aider à se relever ». De Gaulle fera le contraire : en témoigne son projet d’Etat rhénan (octobre 1944) séparé de l’Allemagne, qui recueille à l’époque l’assentiment de 78 %. Le diplomate Jean-Marie Soutou, membre du mouvement Combat, déplore la philosophie « complètement aberrante » de la politique française à l’égard de l’Allemagne en 1945. Le respect de la nation allemande et de son unité est la condition d’« une paix de justice et de générosité et non de haine et d’égoïsme ».
La réconciliation franco-allemande exige l’avènement d’une nouvelle configuration politique qui ne peut être que la solution fédérale. C’est la seule voie possible qui peut permettre la réintégration de l’Allemagne comme une nation à part entière, traitée « sur un pied de stricte égalité avec toutes les autres Nations ». Le bellicisme germanique, assure Frenay, n’aura plus lieu d’être dans ces conditions, et la « mystique nazie » appartiendra au passé. C’est la seule formule qui assurera une paix durable en Europe : car « comment, dans une union européenne bien conçue, l’une des Nations pourrait-elle avoir le moyen de recourir à la guerre ? Peut-on concevoir que la Californie déclare la guerre au Wisconsin ? » Une politique étrangère commune, une armée européenne et la « socialisation » de l’industrie lourde « interdiraient non seulement à l’Allemagne, mais encore à toute autre Nation, de devenir pour les autres un danger. »
Il faut mesurer l’incroyable intuition de ce chef de la Résistance qui, pourchassé par la police de Vichy et de l’occupant, menant une vie de clandestin qui risque sa vie à tous les instants, rêve d’une Europe qui réconciliera les ennemis du moment.
Deux conceptions durablement opposées sur l’Europe à venir
Mais Frenay s’est lourdement trompé en pensant que de Gaulle pouvait accorder intérêt à une vision de l’histoire totalement orthogonale à la sienne. Le discours que prononce de Gaulle à l’Albert Hall le 11 novembre 1942, devant les Français de Londres (Frenay est présent), semble bien loin des préoccupations de Frenay. C’est un puissant appel à l’unité nationale : « La France ! c’est une seule nation, un seul territoire, une seule loi ! » ; « Le but de la lutte est une sorte de restitution de la France seule. Ce discours se termine par : « Un seul combat, pour une seule patrie ! »
La non-réaction du Général pousse Frenay à développer sa thèse sous la forme de deux mémorandums, rédigés les 13 et 14 novembre 1942. Il ose une suggestion plus concrète. Il lui propose de réunir les gouvernements européens en exil à Londres pour devenir leur représentant auprès des Alliés : « Mon général, au lieu de revendiquer pour la France un petit strapontin à la table des Grands, vous pouvez obtenir le grand fauteuil à la table des Petits, et, d’un coup, vous aurez le droit de parler en leur nom, c’est à dire au nom de l’Europe qui, au lendemain de la guerre, poursuivra sur le chemin de l’unité où ici vous l’aurez engagée. » On imagine la réaction de De Gaulle devant un propos si maladroit ! Frenay n’avait rien compris à la personnalité du personnage qui, alors, se prenait pour la France et se proposait de rétablir sa « grandeur ».
Les Mémoires de De Gaulle ne font pas mention de cette lettre, de cette rencontre avec Frenay ou de ses mémorandums. Cela ne surprend pas. De Gaulle, dans la phase initiale de son combat, veut apparaître comme un chef de guerre qui ramasse « le tronçon du glaive» et qui entend maintenir « le droit de la France à la victoire ». Il refuse de se positionner sur le plan politique. Les milieux de la France libre, du moins au tout début de l’aventure, témoignent d’une « tonalité » marquée, comme l’écrit Serge Berstein, par « un nationalisme peu attaché au modèle républicain ». La vision géopolitique du Général, à ce moment, elle est aimantée par ce Jean-Marie Soutou appellera un « solipsisme gallican ». Dans ces années de guerre, et même après, le Général regarde l’Allemagne à travers les dogmes de l’historien maurrassien Jacques Bainville selon qui la sécurité de la France sera toujours conditionnée par l’organisation de la faiblesse de l’Allemagne.
C’est pourquoi on retrouvera après-guerre les mêmes lignes de clivage. Frenay et de Gaulle s’affronteront, par exemple, au sujet de la Communauté européenne de défense. L’européanisme de Frenay est incompatible avec le dogme fondateur de la pensée gaullienne, à savoir « l’État national et souverain dans ses frontières naturelles (…), aboutissement d’une très longue histoire et qu’il ne saurait être dépassé. » De là, bien sûr, sa réticence à l’idée d’un ordre international et supranational.
A l’origine de cette profonde divergence, il y a une analyse radicalement différente des origines et de la nature des guerres qui ont frappé l’Europe. Henri Frenay, comme les historiens de son temps et ceux d’aujourd’hui, refuse une lecture univoque de la conflictualité européenne dont la clé de voûte serait la volonté hégémonique de l’Allemagne. La ligne du général de Gaulle est très différente. Pour lui, comme il le déclare à la BBC le 17 septembre 1941, « le monde fait la guerre de trente ans, pour ou contre la domination universelle du germanisme ». C’est le mythe fameux de la « guerre de trente ans » qui aurait pour unique cause « la fureur germanique », comme le chef de la France Libre la qualifie dans son discours du 11 novembre 1942 prononcé au meeting de l’Albert Hall auquel Frenay a assisté. Dans ce discours, le Général explique que se battre contre l’Allemagne est une fatalité, une « habitude », et ce « bien avant Arminius », ce chef de guerre d’une tribu germanique qui réussit à arrêter la progression de la colonisation romaine. Dans ce discours, l’Europe n’est citée que de manière négative, « sous la direction d’Hitler ». La nation française apportera son concours à « l’effort commun » mais d’abord pour assurer « tous ses droits à la victoire », la victoire qui maintiendra « la France indivisible ».
Henri Frenay n’avait aucune chance de rallier le général de Gaulle à ses vues. Leur confrontation illustre un choc de culture et de légitimité. A travers cette opposition se lisent déjà les difficultés que les pionniers de la construction européenne auront à connaître pour faire valoir la nécessité d’une Europe unie. Emporté par son idéalisme et son volontarisme, Henri Frenay n’a pas conscience que le gaullisme s’inscrit dans un patrimoine politique qui reste attaché au modèle stato-national. Tout clandestin qu’il est, le combattant Frenay est persuadé qu’il représente la France et ses aspirations profondes. Son « projet », comme il l’appelle, est forcément populaire : « Cependant, n’est-il pas présent dans tous les esprits ? N’est-il pas la volonté instinctive des peuples ? » L’erreur des fédéralistes est tout entière dans cette postulation d’une volonté des peuples européens (« le vœu commun des Nations ») qui n’existe pas. Est-il raisonnable de prétendre, comme l’écrit Frenay dans cette lettre, pouvoir « créer l’esprit européen, d’élever nos pensées au-delà des anciennes frontières, de créer une nouvelle communauté spirituelle », au moment où la guerre répand son cortège d’horreurs et d’humiliations? Mais cette erreur est son honneur. Il a compris avec une extrême lucidité que la paix ne pourra se faire sans la réintégration de l’Allemagne et sans la construction de ce qu’il appelle d’une « union européenne » et d’une « communauté européenne ». Ils n’étaient pas si nombreux ceux qui, dès 1942, ont pensé qu’il fallait résister, comme dira Hegel, à « l’impuissance de la victoire ».
Robert Belot
Bibliographie
Belot, Robert, Henri Frenay, de la Résistance à l’Europe, Paris, Seuil, 2004
Berstein, Serge, Histoire du gaullisme, Paris, Perrin, 2001
Maritain, Jacques, L’Europe et l’idée fédérale, Paris, Mame, 1993 (écrit en 1940)
Roussel, Eric, Charles de Gaulle, Paris, Gallimard, 2002
Soutou, Jean-Marie, Un diplomate engagé. Mémoires 1939-1979, Paris, Ed. de Fallois, 2011

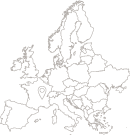 Université Jean Monnet
Université Jean Monnet